ABS : ces trois lettres résonnent familièrement. Tantôt elles intriguent, tantôt elles inquiètent. Que signifie, au juste, « abus de biens sociaux » ? Quels sont les comportements prohibés ? Qui est susceptible de les commettre ?
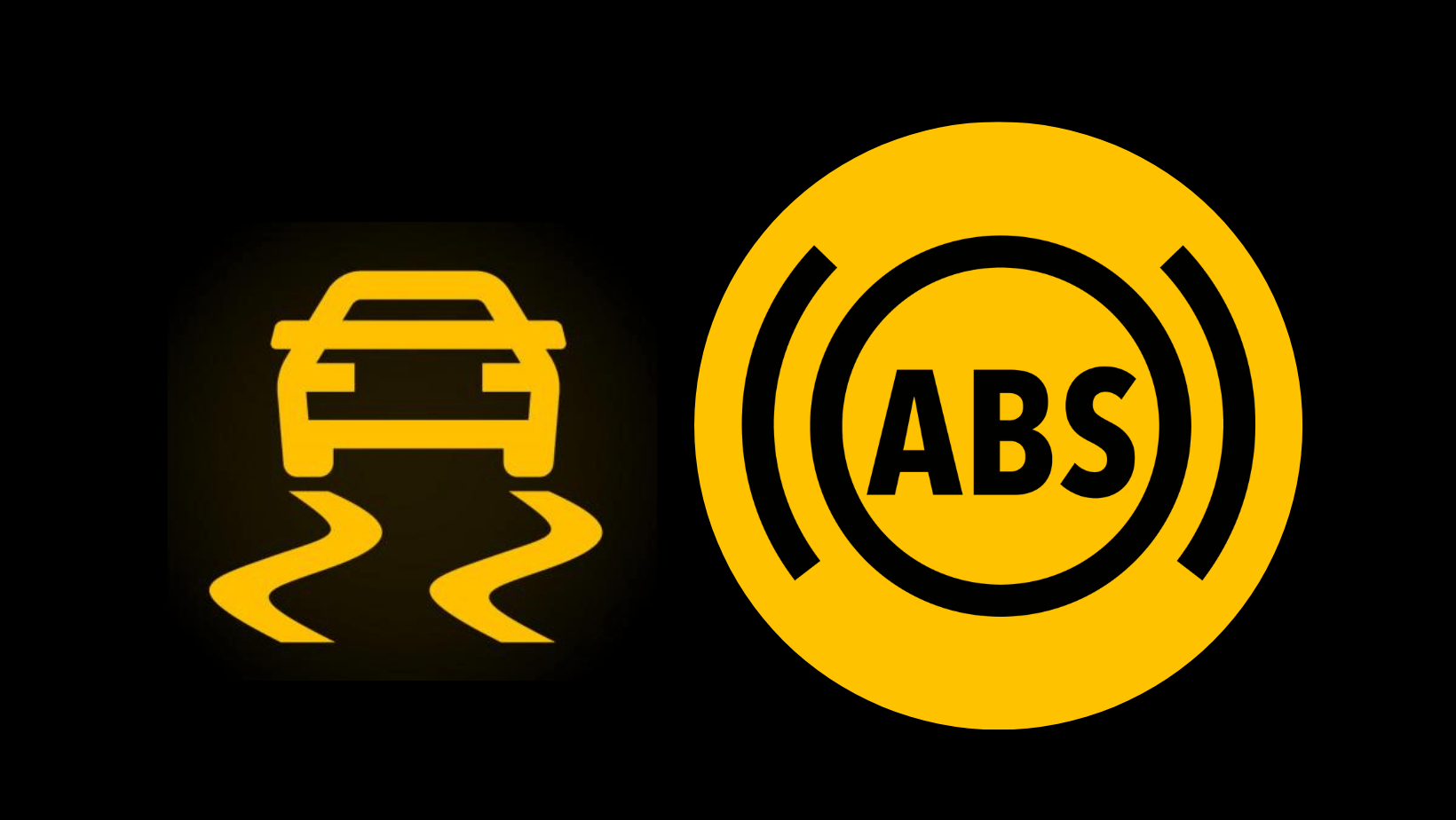
Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 septembre 2022[1] a apporté un éclairage bienvenu sur cette infraction devenue, en un peu moins d’un siècle[2], une des infractions-phares du droit pénal des affaires.
Voici les principales caractéristiques de cette infraction, punie, dans sa forme habituelle, d’une peine maximale de cinq ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende.
Qui est visé ?
Les auteurs de ce délit[3] sont les dirigeants de société, qu’ils soient dirigeants de droit ou dirigeants de fait, qu’ils soient personnes physiques ou personnes morales. Cependant, ne sont pas concernés les dirigeants des sociétés en nom collectif, en commandite simple, en participation ou de fait, le champ d’application de l’infraction n’ayant pas été étendu à ces formes sociales.
Le liquidateur d’une société est également concerné.
La logique est la suivante : en principe, seuls les dirigeants ont à leur disposition les moyens d’abuser des biens de la société, puisqu’ils sont investis d’un pouvoir de représentation. Pour prendre un exemple simple, disposant naturellement des moyens de paiement de la société, un dirigeant peut aisément en abuser.
Les salariés d’une entreprise, en revanche, ne sont pas susceptibles de commettre le délit d’abus de biens sociaux. S’ils venaient à user du patrimoine de la société à des fins personnelles, ils pourraient, sous certaines conditions, être poursuivis pour le délit d’abus de confiance puisque, par hypothèse, les biens de la société ne leur sont que confiés temporairement pour en faire un usage professionnel.
Dans cette même logique, les associés ou actionnaires ne sont pas concernés par le délit d’abus de biens sociaux, mais il n’est pas exclu qu’ils soient visés au titre de la complicité ou du recel.
Qu’appelle-t-on précisément abus ?
A cette question, il n’est pas possible de répondre de manière exhaustive, tant les cas de figure peuvent être nombreux et protéiformes[4].
De façon générale, la loi réprime tout comportement qui reviendrait, pour le dirigeant, à porter atteinte au patrimoine de la société qu’il dirige, laquelle constitue une personne tout à fait distincte de lui-même.
Les chefs d’entreprise, parfois, ne l’assimilent pas : la société qu’ils dirigent, qu’ils ont parfois créée et dont ils sont parfois les seuls membres, a une personnalité juridique indépendante et un patrimoine propre qui ne peut être confondu avec le leur.
Ainsi, utiliser à des fins personnelles le patrimoine de cette société est une forme d’appréhension frauduleuse de la chose d’autrui. L’abus de biens sociaux est une incrimination dont le but est de protéger la personne morale contre ceux qui sont censés servir ses intérêts : ses propres dirigeants[5].
A l’analyse des décisions rendues, il est néanmoins possible de distinguer quatre grands types d’abus.
- La première catégorie, qui semble la plus évidente, consiste, pour le dirigeant, à opérer une confusion entre le patrimoine de la société et le sien, ou celui d’une autre société qu’il dirige.
Les exemples sont nombreux : utiliser le compte bancaire de la société pour financer ses dépenses personnelles, payer ses amendes, ses impôts, payer les dépenses d’une autre société, détourner la clientèle de la société, détourner le temps de travail de ses salariés à des fins personnelles, etc.
Il existe cependant une exception importante : les opérations ou mouvements de fonds entre différentes sociétés appartenant à un même groupe. En effet, ce qui peut nuire à une société prise individuellement (l’octroi d’un concours financier envers une autre société par exemple) peut être bénéfique au groupe lui-même.
Depuis un arrêt de principe[6], la Cour de cassation admet qu’une logique de groupe fasse obstacle à la commission d’un ABS, à plusieurs conditions :
- Être en présence d’un véritable groupe de sociétés ;
- Que l’acte ait une contrepartie et soit justifié par l’intérêt général du groupe, pour le maintien de son équilibre ou l’application d’une politique commune ;
- Que l’acte n’impose pas à la société défavorisée des sacrifices démesurés mettant son avenir en péril. Impossible, par exemple, de contraindre une des sociétés à la faillite pour en sauvegarder une autre.
- La deuxième catégorie, moins évidente, consiste, pour le dirigeant, à s’octroyer une rémunération excessive ou fictive. En effet, il est souvent aisé pour un dirigeant de décider lui-même de ses rémunérations, ou de peser de toute son influence sur une assemblée générale ou un conseil d’administration.
Si la rémunération est hors de proportion avec l’activité réelle du dirigeant ou la santé financière de l’entreprise, ou si le dirigeant n’a pas spontanément limité sa rémunération en cas de crise financière, notamment si la société enregistre des pertes, il peut voir sa responsabilité pénale engagée.
Cette logique prévaut également en ce qui concerne le délit de banqueroute par détournement d’actif : il s’agit de sanctionner un dirigeant qui abuse du patrimoine de la société à son profit et au détriment soit de la société elle-même (cas de l’ABS), soit de la masse des créanciers (cas de la banqueroute).
- La troisième catégorie d’abus est le fait, pour un dirigeant, de posséder un compte courant d’associé débiteur. Pourquoi ?
Il est tout à fait habituel qu’un dirigeant consente à sa société des prêts ou avances. Il peut procéder par des versements de fonds directement dans les caisses sociales, ou bien laisser à la disposition de la société, sur un compte courant d’associé, des sommes que la société lui doit (dividendes, redevances, salaires), mais qu’il renonce temporairement à percevoir.
Ces sommes demeurent toutefois la propriété du dirigeant. Celui-ci peut donc les récupérer à tout moment et les utiliser à sa guise, même à des fins personnelles, mais à la condition que les prélèvements effectués ne soient pas supérieurs aux fonds disponibles sur ce compte.
Ceci est logique, car si le dirigeant utilisait plus de fonds que les fonds disponibles – rendant ainsi son compte courant débiteur –, cela reviendrait à emprunter directement de l’argent à la société, et donc à l’appauvrir. En quelque sorte, le dirigeant contraindrait la société à lui accorder un découvert[7].
A cet égard, le remboursement postérieur du solde débiteur, assimilé à un repentir actif, n’effacerait pas l’infraction commise. De même, une approbation antérieure ou postérieure de l’abus par l’assemblée générale des actionnaires ne saurait effacer l’infraction, le droit pénal n’acceptant pas, par principe, l’excuse du consentement de la victime.
- Enfin, le dernier type d’abus, plus original, est la commission d’une infraction dans l’intérêt de la société. En pratique, il s’agit des cas où un dirigeant cherche à obtenir un avantage pour sa société (un contrat par exemple) en utilisant, de façon illicite, les moyens de la société (en versant un pot-de-vin par exemple). Les moyens sont certes illicites, mais le dirigeant peut avoir indéniablement agi dans l’intérêt de la société. Une corruption pourrait bien avoir eu lieu, mais un abus de confiance l’a-t-il nécessairement été ?
Ce sujet a fait l’objet d’une intense réflexion jurisprudentielle et doctrinale au cours des années 1990-2000, ayant donné lieu à plusieurs arrêts contradictoires qui ont fini par trouver leur épilogue dans l’arrêt « Carignon », selon lequel : « Quel que soit l’avantage à court terme qu’elle peut procurer, l’utilisation des fonds sociaux ayant pour seul objet de commettre un délit tel que la corruption est contraire à l’intérêt social en ce qu’elle expose la personne morale au risque anormal de sanctions pénales ou fiscales contre elle-même et ses dirigeants et porte atteinte à son crédit et à sa réputation »[8].
Faire courir un risque pénal ou fiscal constitue donc un abus dès lors qu’il causerait, s’il se réalisait, un appauvrissement significatif de la société.
Commettre un abus suffit-il à caractériser l’infraction ?
En principe, la simple constatation d’un acte abusif ne suffit pas : il faut aussi prouver que le dirigeant a agi « à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ».
Cependant, la jurisprudence a eu tendance à se montrer peu exigeante : d’une part, sur le fond, elle a adopté une conception large de la notion d’intérêt susceptible d’être poursuivi par le dirigeant, englobant l’intérêt matériel, mais également l’intérêt moral. Il est donc facile de trouver à l’encontre du dirigeant, si ce n’est un intérêt financier, au moins un intérêt moral. D’autre part, sur la forme, la jurisprudence déduit facilement la preuve de cet intérêt personnel de la seule contrariété de l’acte commis à l’intérêt social.
Un arrêt récent, cependant, semble remettre en cause cet excès de facilité, en rappelant que « le caractère fictif des factures acquittées ne saurait à lui seul suffire à présumer que le dirigeant avait soit pris un intérêt direct ou indirect dans le règlement des factures fictives, soit favorisé une autre société ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement »[9].
Par cet arrêt, la Cour de cassation s’inscrit dans un courant d’interprétation plus littérale et rigoureuse[10] donnant ainsi aux dirigeants plus de moyens de défense à opposer.
Maître Bernard RINEAU, Avocat Associé
Maître Jean-Eloi de BRUNHOFF, Avocat en charge du pôle pénal
[1] Crim. 7 sept. 2022, F-D, n° 21-83.823
[2] Sa création date du décret-loi du 8 août 1935 adopté en suite de plusieurs scandales politico-financiers, dont l’affaire Stavisky.
[3] Prévu aux articles L241-3, 4°, L242-6, 3°, L242-30, al. 1 du code de commerce et L231-11, 3 du code monétaire et financier
[4] Droit des sociétés n° 1 du 1er janvier 2023 – Abus de biens sociaux – Le caractère protéiforme de l’abus de biens sociaux – Commentaire par Renaud Salomon
[5] Droit pénal des affaires : sur la recevabilité des parties civiles pour certaines infractions classiques
[6] Arrêt « Rozenblum », Cass. crim., 16 déc. 1975, n° 75 – 91.045
[7] Pour une illustration récente : Cass. crim., 16 juin 2021, n° 20-83.526
[8] Arrêt « Carignon », Cass. crim., 27 oct. 1997, n096-83.698), confirmé par la suite dont récemment : Cass. crim., 22 oct. 2008, n° 07-88.111 ; Cass. crim., 6 avr. 2016, n° 15-81.159 ; Cass. crim., 14 mars 2018, n° 16-82.117
[9] Ibid. note n°1
[10] Cass. crim., 5 mai 2004, n° 03-82.535 ; Cass. crim., 22 sept. 2004, n° 03-81.282
